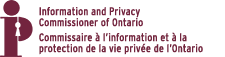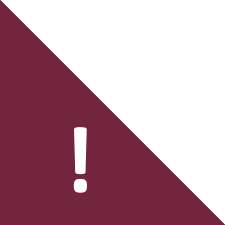La désinformation a été qualifiée de problème déterminant de notre époque, érodant la confiance dans le monde académique, la science et d’autres piliers essentiels de notre société. La commissaire Kosseim s’entretient avec Alex Himelfarb, du Conseil des académies canadiennes, sur ce que nous pouvons faire à ce sujet et sur les raisons pour lesquelles l’accès à des informations fiables et fondées sur des preuves est plus important que jamais.
Les informations, opinions et recommandations présentées dans ce balado sont uniquement destinées à des fins d’information générale. Elles ne doivent pas être considérées comme un substitut à un avis juridique. Sauf indication contraire, le CIPVP ne soutient, n’approuve, ne recommande ou ne certifie aucune information, produit, processus, service ou organisation présentés ou mentionnés dans ce balado, et les informations de ce balado ne doivent pas être utilisées ou reproduites de manière à impliquer une telle approbation ou un tel soutien. Aucune des informations, opinions et recommandations présentées dans ce balado ne lie le Tribunal du CIPVP qui peut être appelé à enquêter de manière indépendante et à décider d’une plainte ou d’un appel individuel sur la base des faits spécifiques et des circonstances uniques d’un cas donné.
Patricia Kosseim :
Bonjour. Ici Patricia Kosseim, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, et vous écoutez L’info, ça compte, un balado sur les gens, la protection de la vie privée et l’accès à l’information. Avec des invités de tous les milieux, nous parlons de questions qui les intéressent sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information.
Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à un autre épisode de L’info, ça compte. La désinformation (ou mésinformation) est devenue un grave problème à notre ère numérique. Un rapport publié récemment par le Conseil des académies canadiennes considère qu’il s’agit d’un problème crucial de notre époque. La mésinformation représente des idées fausses et faits trompeurs que les gens croient vrais; la désinformation (le terme que nous privilégions ici) consiste à répandre délibérément de tels faits ainsi que des mensonges et des rumeurs, sachant qu’ils sont faux. Si elle n’est pas contrôlée, la désinformation peut engendrer confusion et méfiance, et se répandre comme une traînée de poudre. Grâce aux réseaux sociaux, les utilisateurs peuvent être encouragés et récompensés lorsqu’ils partagent fréquemment des informations. Les fausses informations peuvent avoir des conséquences graves et profondes, comme nous l’avons constaté lors de la pandémie de COVID-19. Des renseignements erronés sur le virus ont incité des gens à opter pour des traitements dangereux et inefficaces, voire à ne pas se faire soigner du tout, ce qui a contribué à la propagation du virus.
Au fil du temps, les gens peuvent finir par douter de l’exactitude des renseignements émanant de sources légitimes, ce qui nuit aux efforts déployés pour lutter contre le changement climatique et ébranle la confiance dans les institutions publiques et la démocratie elle-même. Dans cet épisode, nous parlerons des dangers de la désinformation et de ce que les gouvernements, les législateurs, les médias, les réseaux sociaux et les gens ordinaires peuvent faire pour enrayer sa propagation. Je reçois Alex Himelfarb, président du comité directeur du Conseil des académies canadiennes, qui a également dirigé le comité d’experts sur les conséquences socio-économiques de la mésinformation en science et en santé. Bienvenue, Alex.
Alex Himelfarb, Ph. D. :
Merci beaucoup, madame la commissaire. Je suis ravi d’être avec vous.
PK :
Alex, vous avez eu une carrière exceptionnelle. Vous avez été professeur de sociologie, haut fonctionnaire au sein du gouvernement fédéral pendant 30 ans et greffier du Conseil privé au service de trois premiers ministres. Dites-nous ce qui vous a amené à présider le comité d’experts sur la mésinformation en science et en santé.
AH :
Depuis que j’ai quitté la fonction publique et le monde universitaire, je me concentre sur la justice sociale et la justice environnementale, et il m’est apparu de plus en plus clairement que l’un des obstacles au progrès dans les domaines qui me tenaient le plus à cœur était la désinformation, qui représente un obstacle au progrès collectif. Il est intéressant de noter que lorsque l’OMS parlait de santé publique en pleine pandémie de COVID, elle expliquait également que sa lutte contre la COVID devait s’accompagner d’une lutte tout aussi soutenue contre l’infodémie, cette désinformation massive qui empêchait les gens de se protéger eux-mêmes et les uns les autres et qui exerçait une pression énorme sur les professionnels de la santé et les travailleurs de première ligne. Quelques mois à peine plus tard, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a déclaré que l’un des principaux obstacles au progrès dans la lutte contre le changement climatique était la désinformation, y compris celle soutenue par la classe politique, parce qu’elle est particulièrement néfaste du fait qu’elle mine la volonté de poser les actes difficiles que collectivement, nous devons nous résoudre à poser pour relever les défis qui se présentent. Alors oui, la désinformation fait obstacle à la prise de décisions personnelles et collectives qui revêtent une grande importance pour notre santé et notre bien-être.
PK :
Comme vous l’avez mentionné dans l’introduction du rapport, la désinformation n’est pas vraiment un phénomène nouveau. « Les mythes, les théories du complot et la tromperie délibérée sont probablement aussi vieux que la communication humaine », avez-vous écrit, et pourtant, comme vous l’avez ajouté, la désinformation est un problème crucial de notre époque. Comment en sommes-nous arrivés là?
AH :
Ce n’est pas nouveau, mais quelque chose a changé. En 2016, le dictionnaire Webster a nommé « post-truth », postvérité, le mot anglais de l’année. Et l’ai dernier, le mot de l’année était « gaslighting », détournement cognitif. Donc il y a quelque chose qui se passe. Qu’est-il arrivé? Le premier facteur, je crois, c’est l’essor des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie personnelle comme véhicules d’information. Un sondage récent a révélé que pendant la pandémie de COVID, environ 90 % des Canadiens s’informaient par l’entremise des réseaux sociaux et des applications de messagerie. Cela signifie qu’ils sont exposés à d’énormes quantités d’information, mais aussi de désinformation, et presque toujours sans intermédiaire, sans repères, sans personne pour les aider à distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas. Et comme vous l’avez dit, cela mène à s’enfermer dans des bulles d’information qui se renforcent elles-mêmes. Les algorithmes et les incitatifs intégrés dans les réseaux sociaux font en sorte que les conflits, les affrontements et la désinformation sont très populaires et se répandent rapidement.
Ajoutez à cela le deuxième grand facteur, à savoir le déclin, depuis des décennies, de la confiance dans les institutions publiques et le gouvernement, mais également dans les médias, les universités et les institutions privées. Il y a donc un déclin de la confiance en l’autre, un déclin de la confiance sociale et un déclin de la confiance dans la politique. Les recherches montrent que les gens n’ont pas vraiment perdu confiance dans la science. Ils ont plutôt perdu confiance dans les institutions auxquelles ils faisaient appel pour obtenir des informations scientifiques. Ils ne croient donc plus au gouvernement comme avant. Ils ne croient plus aux organismes publics comme avant. Ils ne croient même plus aux universités comme avant. Et les professionnels des médias vous diront qu’ils ne croient plus les médias grand public comme avant.
Donc chacun trouve ses propres sources, dans sa bulle où l’on confirme ce que l’on croit déjà, sans intermédiaire, sans confiance. Ajoutons à cela que nous vivons à une époque de crises multiples et multidimensionnelles. La démocratie est en crise, une pandémie sévit, le tissu social se délite, et en temps de crise, les gens recherchent un degré de certitude que la science et les connaissances scientifiques n’apportent pas ou pas assez rapidement, et il est difficile d’obtenir une telle certitude, mais les gens la réclament, et ils cherchent souvent des boucs émissaires. Cela nous rend très vulnérables aux théories du complot et à la désinformation. Quand ces trois facteurs sont réunis, c’est la tempête parfaite.
PK :
Ce rapport s’appelle Lignes de faille. Dès votre introduction, je perçois plusieurs de ces lignes de faille. Dites-moi, en quoi ce titre est-il significatif? De quelles lignes de faille parlez-vous?
AH :
Il y en a toute une série. Celles qui divisent les classes et les races, les conséquences persistantes du colonialisme, les lignes de faille du sexe, de l’expérience des personnes handicapées, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. La désinformation se nourrit de ces lignes de faille, les creuse, les transforme en crevasses. L’une des conséquences collectives concrètes de la désinformation est la rupture de la cohésion sociale. La désinformation est désormais liée à l’identité et à l’idéologie. Autrefois, il pouvait arriver que les invités à une soirée soient en désaccord sur un sujet donné. Aujourd’hui, on se jette des objets à la figure, et on assiste à des attaques troublantes et virulentes contre des politiciens, des journalistes et des travailleurs de la santé de première ligne, en particulier des femmes et des travailleurs racialisés.
C’est un résultat de ce changement qui fait que la désinformation fait désormais partie de notre identité; on se dit, vous êtes avec nous ou contre nous. Il est important dans ce contexte de ne pas condamner les personnes qui disent ne pas vouloir se faire vacciner. Il faut éviter de creuser ces lignes de faille. La méfiance des gens peut avoir de nombreuses causes qu’il faut comprendre. Et le comportement des gens repose sur bien d’autres facteurs que la désinformation. Alors il faut éviter de poser des hypothèses qui viennent exacerber ces divisions.
PK :
On a donc demandé au comité d’examiner les conséquences socio-économiques de l’information en science et en santé sur le public et les politiques publiques au Canada. Quelles ont été les conclusions du comité?
AH :
Nous avons fourni de nombreuses données montrant que la désinformation sur les vaccins nous rendait vulnérables à des maladies évitables, à l’hospitalisation et à la mort. Je ne m’attarderai pas trop aux chiffres, mais on a calculé les souffrances personnelles que cela a engendré, ainsi que les coûts collectifs. Ces exemples me semblent donc évidents. Si les gens ne prennent pas les mesures préventives qui peuvent les aider ou s’ils prennent des médicaments qui ne sont pas destinés à l’usage qu’ils en font, ils en subiront les conséquences. Et c’est malheureusement ce qui est arrivé à des milliers de personnes. Le rapport regorge d’exemples de personnes qui ont été incapables d’empêcher que des incidents fâcheux se produisent ou qui ont provoqué des situations regrettables qui auraient pu être évitées si elles avaient disposé d’informations fiables ou si elles avaient au moins réfléchi aux risques d’agir en fonction des informations dont elles disposaient.
Il y a des répercussions ou des coûts secondaires, comme les coûts pour le système de santé. Le système de santé a été surchargé parce que des gens qui auraient pu se protéger contre la maladie ne l’ont pas fait, de sorte que d’autres personnes n’ont pas été soignées. Nous savons le fardeau que cela a représenté pour les travailleurs de la santé, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan émotionnel. Et puis il y a bien sûr certains des coûts collectifs dont nous avons déjà parlé, les bouleversements sociaux, l’effondrement du consensus social, lequel est nécessaire pour prendre des mesures collectives. La désinformation a ralenti les progrès en matière de changement climatique, les débats sur son existence ont vraiment freiné les progrès et la discussion continue d’évoluer, mais la désinformation est toujours à la base, et il est déjà bien assez difficile de faire ce qu’il faut pour résoudre les problèmes qui se présentent. Déjà c’est presque impossible. Si nous ne parvenons pas à nous entendre sur notre situation actuelle, il est difficile d’imaginer qu’un jour nous nous mettrons d’accord sur la direction à prendre.
PK :
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les conclusions du groupe d’experts et notamment sur le fait que les communautés racialisées et mal desservies sont les plus touchées, de manière disproportionnée, par la désinformation? À quel point les communautés marginalisées sont-elles vulnérables aux effets de la désinformation?
AH :
Il n’est pas étonnant que les communautés vulnérables et marginalisées paient le plus lourd tribut à la désinformation. Ce sont elles qui souffrent le plus de tout ce qui ne va pas dans notre monde, mais cela tient en partie au fait qu’elles n’ont pas accès à des renseignements fiables. Tout le monde n’a pas un accès égal à des renseignements et à des informations scientifiques fiables. Cela tient en partie à une méfiance légitime et compréhensible à l’égard des institutions publiques qui pourraient être des sources d’aide ou de renseignements pertinents, et en partie à l’absence de solutions de rechange, au fait que l’on ne dispose pas des ressources nécessaires pour choisir de bonnes solutions de rechange. Ainsi, lorsqu’il y a des conséquences collectives, elles frappent toujours les plus vulnérables le plus durement, même s’ils sont bien informés. Il y a donc toute une série de raisons et il a été prouvé à maintes reprises que ce sont eux qui paient le prix le plus élevé.
PK :
Je ne sais pas si le comité a eu l’occasion de réfléchir à cette question dans le contexte de l’intelligence artificielle, mais l’IA est en plein essor; nous avons vu des images d’apparence tout à fait authentique du pape portant un blouson blanc bouffant ou de l’ancien président Donald Trump en combinaison orange, menotté, que l’on emmène après sa mise en accusation, ce qui n’est jamais arrivé, bien entendu. Mais ces images ont l’air tellement vraies, et on peut s’attendre à qu’elles s’améliorent encore plus, ce qui aggravera le problème de la désinformation. Qu’en pensez-vous? Devrions-nous être pessimistes ou optimistes?
AH :
Je pense que les risques sont réels; ils ne se situent pas dans un avenir lointain, mais bien aujourd’hui, comme vous l’avez dit. Même avant le développement de l’IA accessible au public, il était assez facile de falsifier des choses sur Internet. Et oui, je pense que l’IA rendra les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides. Il n’est pas rare que la technologie progresse plus vite que la loi et la culture; nous marquons toujours le pas sur l’innovation technologique. Mais je pense que nous allons la rattraper. Je constate que certains journaux affirment déjà qu’ils n’utiliseront pas l’IA, même lorsque cela pourrait être utile, parce qu’ils ne veulent pas ébranler la confiance qu’on leur accorde. Je tiens à préciser que de toute évidence, il y a des utilisations de l’IA qui sont très favorables à la société. Il faut les gérer dans un cadre légal, culturel et éthique. Et nous aurons du rattrapage à faire, mais je suis persuadé que nous y parviendrons. Entre-temps, nous devrons faire preuve d’une grande vigilance. Je pense qu’à l’avenir, nous serons plus disposés qu’auparavant à réglementer les réseaux sociaux.
PK :
Dans son rapport, le groupe d’experts évoque certains signes révélateurs de désinformation auxquels les gens peuvent être attentifs ou dont ils devraient être conscients. Pouvez-vous nous donner des exemples de ces indicateurs qui devraient nous rendre méfiants ou sceptiques à l’égard des informations que nous voyons ou que nous consultons en ligne?
AH :
Au-delà de la désinformation délibérée et révélatrice, et effectivement, il y a beaucoup d’indicateurs de cette désinformation, dont certains termes qui sont utilisés, mais de manière plus générale, je pense qu’il faut se méfier de tout compte-rendu concernant une seule étude qui prétend fournir une réponse définitive à une question importante. Il ne s’agit pas nécessairement de tromperies ou des réseaux sociaux; même les médias grand public seront parfois incités à dramatiser une étude parce qu’elle attire l’attention et fera vendre des journaux. Même des scientifiques sont parfois tentés d’exagérer l’importance de leurs études afin qu’elles soient publiées et visibles. Il faut apprendre à ne rien croire de ce que l’on trouve dans une seule étude, ou de ce qui émane d’un seul expert. Il faut rechercher de plus en plus ce qui représente le meilleur consensus scientifique, en sachant qu’il reste toujours de l’incertitude. Il faut fuir quiconque essaie de nous vendre des certitudes.
PK :
Le comité s’est penché sur la désinformation dans le contexte de l’information en science et en santé, mais le problème est bien plus profond et ébranle même les piliers de notre démocratie. L’exemple récent de Fox News, qui a reconnu avoir fait de fausses déclarations voulant que Dominion Voting Systems ait truqué les élections présidentielles américaines de 2020, montre à quel point cette pratique peut être répandue, en particulier dans le cas de la chaîne d’information la plus regardée aux États-Unis, qui a dû débourser près de 790 millions de dollars pour régler le litige. Que pensez-vous des répercussions possibles de la désinformation sur un aspect aussi fondamental que les élections et les fondements de notre démocratie?
AH :
Le comité ne s’est pas concentré sur la désinformation politique et l’utilisation délibérée de la désinformation à des fins politiques, mais on ne peut pas séparer la désinformation en science et en santé de la désinformation politique, parce que les deux se rejoignent. On a vu la politique de désinformation sur les vaccins et la façon dont on peut se constituer un électorat politique autour des théories du complot. Plus les gens adhèrent à une vision conspirationniste du monde, plus ils sont disposés à participer à une conspiration politique, de sorte que la politique et la désinformation peuvent se renforcer d’elles-mêmes. Alors oui, cela se répercute profondément sur notre vie politique et c’est, à mon avis, une menace importante pour les principes et les institutions démocratiques. La raison en est que dans les pays autoritaires, la désinformation est un outil que l’on emploie délibérément pour miner toute opposition éventuelle et maintenir le contrôle. Hannah Arendt a écrit que le premier signe de la montée de l’autoritarisme est la dégénérescence de la vérité.
Et quand il faut s’en remettre à des personnages influents comme source de vérité plutôt qu’aux institutions traditionnelles, c’est une véritable menace pour la démocratie. Cela ébranle la démocratie. En un sens, la démocratie repose sur le fait d’être suffisamment renseigné pour pouvoir prendre des décisions collectives en toute connaissance de cause. Tout comme il faut être bien renseigné pour prendre des décisions sur notre bien-être personnel. L’un des membres du comité a affirmé qu’il s’agit d’un droit démocratique, le droit de disposer des renseignements nécessaires pour prendre collectivement des décisions éclairées sur notre avenir. La désinformation sape ce processus et donc la démocratie, mais elle alimente également l’autocratie, l’autoritarisme, et il existe une abondante documentation qui montre que cette crainte est loin d’être farfelue. Il existe des exemples éloquents et sérieux de situations où la désinformation a alimenté des autocraties et les a maintenues au pouvoir.
PK :
C’est intéressant parce que vous disiez que l’un des antidotes à la désinformation est de favoriser la multiplicité des sources d’information et d’informations compensatoires. J’aimerais savoir ce qu’a constaté le comité, mais aussi, d’après votre expérience personnelle en tant que haut fonctionnaire pendant plus de 30 ans sous trois gouvernements, quel est le rôle du gouvernement? Quel rôle jouent la transparence et la divulgation proactive pour combler les lacunes et donner accès à des sources de vérité?
AH :
Je pense que c’est un aspect très important, en particulier pour le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, mais à notre époque de désinformation où la confiance ne règne plus, le fait de ne pas révéler d’informations ne fait qu’intensifier la pression pour trouver des explications, ce qui alimente la pensée conspirationniste. Cela fait désordre. Bien des mesures et des décisions prises par le gouvernement sont difficiles à gérer et parfois, quand on les révèle, on en subit les conséquences, mais quand on les dissimule, c’est encore pire. Quand on fait le ménage du printemps, on soulève la poussière partout, mais si on ne le fait pas, c’est bien pire, et il en va de même pour l’information. Il serait donc naïf de penser que tout divulguer permettra d’instaurer un climat de confiance du jour au lendemain. En fait, cela même peut engendrer des doutes, mais il n’y a rien de pire que de cacher la vérité. Je pense donc que le gouvernement a un rôle énorme à jouer en faisant preuve d’une transparence proactive et en s’appuyant moins sur les demandes d’accès à l’information.
L’autre point qui me semble très important est la manière dont nous traitons l’information, même lorsqu’elle est publique. Tout le monde aime parler de politiques fondées sur des données probantes. Comment peut-on ne pas aimer les politiques fondées sur des données probantes ? Nous aimons les politiques, nous aimons les données probantes. Les politiques fondées sur des données probantes, c’est comme la tarte aux pommes et la crème glacée, mais on s’en sert souvent pour se cacher derrière la science, alors que la science ne nous dit pas quelle est la bonne chose à faire. Elle nous indique les coûts des différentes options, et les jugements moraux et de valeur que nous portons, ainsi que les données probantes, nous indiquent la bonne chose à faire. Il ne faut pas se cacher derrière la science, et il faut avoir ces discussions d’ordre moral, sinon nous nuisons à la science. Considérons la science comme le savoir que nous utilisons pour évaluer les risques et les avantages et reconnaissons que lorsque nous évaluons ces risques et ces avantages, nous le faisons en fonction de certaines valeurs qui doivent être clairement définies. Alors je crois que oui, adoptons la divulgation proactive, même si les conséquences sont parfois désagréables, mais ne nous cachons pas derrière le savoir, tenons ces discussions d’ordre moral, afin que le gouvernement soit le leader moral qu’il doit être.
PK :
Je sais que le comité s’est intéressé à d’autres parties prenantes : les législateurs, les réseaux sociaux, le journalisme, les médias et même les particuliers; vous et moi, nous avons un rôle à jouer pour chasser les mythes et lutter contre les idées fausses et la désinformation. Pouvez-vous nous en dire davantage et nous expliquer ce que nous pouvons tous faire?
AH :
Avant tout, je conseille de prendre le temps de réfléchir. Avant de cliquer pour partager un gazouillis, relisez-le et demandez-vous si la source est fiable. La connaissez-vous? Voulez-vous vraiment en faire part à d’autres personnes sans en savoir plus? Avez-vous vérifié? Donc prenez votre temps. Posez-vous des questions. Je crois qu’il est vraiment important de prendre au sérieux le fait qu’en partageant un gazouillis, vous faites part à d’autres personnes d’une information qui pourrait être erronée. Partager quelque chose, ce n’est pas un geste banal. Savez-vous de quel magazine il s’agit? Avez-vous déjà entendu parler de ce scientifique? Connaissez-vous sa réputation dans la collectivité? Pour quelle raison voulez-vous partager ce gazouillis? Donc je pense que tout le monde pourrait être plus prudent à cet égard. Il y a trois catégories d’interventions qui se sont révélées efficaces à mon avis. La première est de lutter directement contre la désinformation, de l’identifier, de la désigner comme telle et d’en réduire la quantité qui circule.
À cet égard, il existe un merveilleux programme qu’ont lancé les Nations Unies avec la participation de 19 pays, l’initiative Verified. Elle consiste à surveiller, sur Internet, les domaines où la désinformation pourrait porter atteinte au bien-être de la population. Ils identifient cette désinformation comme telle puis inondent cette partie d’Internet, ce réseau social ou autre de renseignements très fiables et très accessibles sous diverses formes. Donc la solution consiste en partie à faire face à la désinformation directement, à l’identifier, à la désigner comme telle et à la démystifier. Et il faudrait donc notamment, à mon avis, être un peu plus audacieux quant à la réglementation des réseaux sociaux. Tous les membres du comité, et vous aussi sans doute, nous sommes résolus à préserver la liberté d’expression, et nous ne voulons pas dicter ce qui est vrai du haut d’un quelconque ministère de la Vérité. Cependant, nous pouvons exiger que les réseaux sociaux prennent au sérieux leur rôle de modérer les contenus et qu’ils nous disent comment ils s’y prennent, et qu’ils prennent aussi au sérieux la nécessité de faire preuve de transparence quant au fonctionnement de leurs algorithmes et des mesures qu’ils prennent afin de ne pas contribuer à propager de la désinformation.
Et ce faisant, en les obligeant à être plus transparents, nous en apprendrons beaucoup plus sur ce qui se passe et sur la manière d’y faire face. Je réglementerais également leur utilisation des renseignements personnels. Pour qu’ils ne puissent pas continuer à me désinformer parce qu’ils connaissent mes points vulnérables. Il y a des choses que nous pouvons faire qui sont tout à fait compatibles avec la préservation de la liberté d’expression et qui ne consistent pas à déclarer du haut d’une tribune ce qui est vrai ou ce qui ne l’est pas, et qui nous permettent tout de même de progresser. Je crois que la deuxième chose à faire est de renforcer la capacité des gens à départager le vrai du faux, en intégrant dans les programmes d’études des compétences en pensée critique, en littératie, en numératie. Par exemple, en Finlande, un programme offert dans le système scolaire consiste à enseigner aux enfants comment reconnaître la désinformation, comment se prémunir contre elle, et ce programme est couronné de succès.
Donc, dans l’immédiat, nous devrions dire aux gens ce à quoi ils doivent faire attention. C’est l’une de vos questions. Quels sont les signes? Il est très facile, par exemple, pour des sites de se faire passer pour des sites de médias légitimes et de se donner des attributs et des noms. Regardez bien, vérifiez deux fois plutôt qu’une, assurez-vous que c’est un vrai site. Enfin, vous et moi avons déjà abordé la question de savoir comment mieux présenter des informations fiables afin qu’elles soient plus accessibles, ce qui veut également dire qu’il faut être honnête quant à son degré d’incertitude. La science est communiquée de deux manières. L’une consiste à persuader et l’autre à instaurer la confiance. Il faut cesser de communiquer la science à des fins de persuasion et la communiquer davantage dans le but de susciter la confiance. Cela signifie qu’il faut être honnête quant à ses qualifications, être honnête quant au degré d’incertitude, se corriger lorsque les données probantes l’exigent.
Il faut rendre les informations fiables accessibles, transparentes, honnêtes et essentielles. Tout cela est vital. Je pense également que les lieux de savoir doivent nouer des relations avec les communautés qu’ils desservent. Ils doivent établir la confiance, non pas lors d’une situation d’urgence, mais jour après jour, ils doivent faire participer la communauté à leur travail, aider la communauté à comprendre ce qu’est leur travail, ils doivent amener la communauté à eux et être dans la communauté, s’y intégrer. Voilà donc les trois volets. Identifier, étiqueter, démystifier, mieux préparer les gens à composer eux-mêmes avec l’information et communiquer des informations fiables mieux que nous l’avons fait jusqu’à présent.
PK :
Sans doute qu’en tant que haut fonctionnaire, vous avez été confronté à la question de l’accès à l’information. Vous avez eu affaire à des commissaires à la protection de la vie privée et à des commissaires à l’information. Permettez-moi de vous demander ce que le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario pourrait faire, selon vous, pour contribuer à mettre en œuvre les solutions que vous présentez dans votre rapport, certaines de ces solutions. Notre bureau a bien entendu pour mission de protéger la vie privée, mais aussi de promouvoir la transparence. Donc, sur ces deux plans, que pouvons-nous faire de mieux ou de plus?
AH :
Quand j’étais fonctionnaire, je n’étais pas toujours un modèle en matière d’accès à l’information; ça exige beaucoup de travail, et c’est parfois difficile compte tenu des délais qui nous sont accordés. Je ne cherche pas d’excuses, les choses se sont améliorées progressivement. Mais si vous pouviez encourager les services à ne pas attendre de recevoir une demande, à mettre en place des systèmes permettant de mettre leurs renseignements à disposition de manière proactive, de faire savoir qu’ils sont disponibles et pas seulement d’une manière compliquée que seul un expert pourra trouver, mais d’une manière vraiment accessible, je pense que ce serait, à terme, un moyen de renforcer la confiance, et quel bureau que le vôtre serait le mieux placé pour le faire? Et en fait c’est une façon moins punitive, moins axée sur l’application de la loi, d’envisager votre mandat, de dire écoutez, n’attendez pas de recevoir des demandes parce que nous savons que c’est difficile d’y répondre. Divulguez l’information, tout de suite.
PK :
C’est intéressant parce que je vous ai dit, je crois, que nous avons lancé un Défi de la transparence un peu plus tôt cette année pour découvrir d’excellents exemples d’initiatives de données ouvertes, de gouvernement ouvert et de divulgation proactive que nous avons mis en vedette dans une Vitrine de la transparence. Nous espérons que cette vitrine encouragera d’autres organisations à se dire, en voyant ces exemples, nous pourrions faire la même chose, et nous pourrions avoir le courage d’être proactifs avec les renseignements dont nous disposons et de les rendre accessibles d’une manière élégante, que les gens peuvent comprendre et utiliser. J’aimerais connaître votre point de vue, Alex. À votre avis, avons-nous atteint notre but et avons-nous au moins fait bouger les choses un peu en favorisant l’ouverture?
AH :
À mon avis, c’est une excellente initiative. C’est exactement le genre de chose que votre commission peut faire et qui ferait vraiment bouger les choses.
PK :
Eh bien, merci beaucoup, Alex. Voilà une note encourageante pour terminer. Ce fut une discussion très informative et éclairante. J’ai beaucoup appris en m’entretenant avec vous et en lisant le rapport, dont j’invite nos auditeurs, et tous ceux qui le souhaitent, à se procurer un exemplaire et à le lire. Il s’agit d’un long rapport, mais le résumé est une excellente synthèse de ses principaux messages. Merci encore une fois, Alex.
AH :
Tout le plaisir était pour moi. Merci de m’avoir invité.
PK :
Les auditeurs qui souhaitent lire le rapport Lignes de faille le trouveront sur le site Web du CAC ou pourront cliquer sur le lien fourni dans les notes de cet épisode. Ceux qui veulent en savoir davantage sur la protection de la vie privée et la transparence peuvent consulter notre site Web à cipvp.ca. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous envoyer un courriel si vous avez besoin d’aide ou de renseignements généraux concernant les lois ontariennes sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Merci à tous d’avoir été à l’écoute, et je tiens à vous assurer que cet épisode de L’info, ça compte est bien réel, et que je me suis vraiment entretenue avec Alex Himelfarb. Merci et à la prochaine.
Ici Patricia Kosseim, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, et vous avez écouté L’info, ça compte. Si vous avez aimé ce balado, laissez-nous une note ou un commentaire. Si vous souhaitez que nous traitions d’un sujet qui concerne l’accès à l’information ou la protection de la vie privée dans un épisode futur, communiquez avec nous. Envoyez-nous un gazouillis à @cipvp_ontario ou un courriel à [email protected]. Merci d’avoir été des nôtres, et à bientôt pour d’autres conversations sur les gens, la protection de la vie privée et l’accès à l’information. S’il est question d’information, nous en parlerons.
Alex Himelfarb, Ph. D., est président du comité d’experts sur les conséquences socio-économiques de la mésinformation en science et en santé du Conseil des académies canadiennes, dont il préside également le comité directeur. Il est président du conseil d’administration de la publication The Narwhal et siège aux conseils de l’Atkinson Foundation et de la Public Service Foundation; il fait également partie du comité consultatif du vérificateur général et est membre de l’Institut Broadbent et du Parkland Institute.
- Direction du comité d’experts sur la mésinformation en science et en santé [2:30]
- La désinformation est devenue un problème crucial de notre époque. Pourquoi? [3:56]
- Les réseaux sociaux, la perte de confiance et la recherche de certitude [4:17]
- Les lignes de faille dans la société moderne [7:08]
- Les conséquences socio-économiques de la désinformation en science et en santé [8:57]
- Les répercussions de la désinformation sur les communautés vulnérables et marginalisées [11:00]
- Quel avenir nous réserve l’essor de l’IA? [12:36]
- Les signes révélateurs de la désinformation [14:29]
- L’incidence de la désinformation sur la démocratie [16:00]
- Le rôle de la transparence du gouvernement et de l’accès à l’information pour lutter contre la désinformation [19:02]
- Comment les citoyens peuvent lutter contre la désinformation [22:04]
- Intégration de la pensée critique, de la numératie et de l’éducation aux médias dans les programmes scolaires [25:20]
- Communication de l’information de façon plus accessible [26:14]
- Divulgation proactive d’information par les institutions publiques [28:13]
Ressources
- Lignes de faille (rapport du comité d’experts sur les conséquences socio-économiques de la mésinformation en science et en santé, Conseil des académies canadiennes, 26 janvier 2023)
- Verified (projet des Nations Unies visant à améliorer l’accès à des renseignements exacts)
- La Vitrine de la transparence du CIPVP met en vedette des projets de gouvernement ouvert (communiqué du CIPVP, 11 mai 2023)
- Le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée invite les institutions publiques à relever le Défi de la transparence (communiqué du CIPVP, 28 septembre 2023)
- Priorités stratégiques du CIPVP 2021-2025
L’info, ça compte est un balado sur les gens, la protection de la vie privée et l’accès à l’information animé par Patricia Kosseim, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Avec des invités de tous les milieux, nous parlons des questions qui les intéressent le plus sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information.
Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note ou un commentaire.
Vous aimeriez en apprendre plus sur un sujet lié à l’accès à l’information ou la protection de la vie privée? Vous aimeriez être invité à une émission? Envoyez-nous un gazouillis à @cipvp_ontario ou un courriel à [email protected].
Les renseignements, opinions et recommandations que contient ce balado sont présentés à des fins d’information générale uniquement, et ne peuvent pas se substituer à des conseils juridiques. Sauf indication contraire, le CIPVP ne soutient, n’approuve, ne recommande, ni n’atteste aucun renseignement, produit, processus, service ou organisme présenté ou mentionné dans ce balado. En outre, les renseignements que contient ce balado ne doivent pas être utilisés ni reproduits d’une manière qui sous-entend un tel soutien ou une telle approbation. Les renseignements, opinions et recommandations présentés dans ce balado ne lient pas le Tribunal du CIPVP, qui peut être appelé à enquêter et à rendre une décision sur une plainte ou un appel en se fondant sur les circonstances et les faits pertinents.
This post is also available in: Anglais