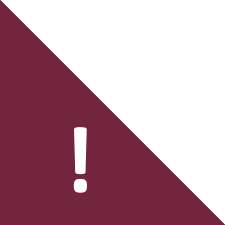S3-Épisode 4 : Les utilisations éthiques des données génétiques : entretien avec Bartha Knoppers, Ph. D.
La commissaire Kosseim s’entretient avec Bartha Knoppers, Ph. D., directrice du Centre de génomique et politiques de l’Université McGill, des aspects juridiques et éthiques de la recherche génétique menée pour le bien commun.
Les informations, opinions et recommandations présentées dans ce balado sont uniquement destinées à des fins d’information générale. Elles ne doivent pas être considérées comme un substitut à un avis juridique. Sauf indication contraire, le CIPVP ne soutient, n’approuve, ne recommande ou ne certifie aucune information, produit, processus, service ou organisation présentés ou mentionnés dans ce balado, et les informations de ce balado ne doivent pas être utilisées ou reproduites de manière à impliquer une telle approbation ou un tel soutien. Aucune des informations, opinions et recommandations présentées dans ce balado ne lie le Tribunal du CIPVP qui peut être appelé à enquêter de manière indépendante et à décider d’une plainte ou d’un appel individuel sur la base des faits spécifiques et des circonstances uniques d’un cas donné.
Patricia Kosseim :
Bonjour. Ici Patricia Kosseim, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, et vous écoutez L’info, ça compte, un balado sur les gens, la protection de la vie privée et l’accès à l’information. Avec des invités de tous les milieux, nous parlons de questions qui les intéressent le plus en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée.
Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à un autre épisode de L’info, ça compte. Nous accueillons aujourd’hui une invitée très spéciale, que j’ai le privilège de connaître depuis l’époque où j’étais étudiante à l’Université McGill : Bartha Maria Knoppers, experte et pionnière de renommée mondiale dans les domaines de la santé, du droit et de la bioéthique, et particulièrement de la génomique. Ses travaux novateurs ont profondément transformé notre compréhension de l’intersection complexe entre la science, le droit, la technologie et l’éthique. Elle est actuellement directrice du Centre de génomique et politiques de l’Université McGill, où elle collabore avec des organisations internationales, des gouvernements et des décideurs pour contribuer à établir des critères éthiques qui protègent les droits de la personne tout en favorisant la santé et le bien-être des personnes et des collectivités. Dans cet épisode, nous aborderons des considérations juridiques et éthiques entourant la recherche génétique menée pour le bien commun, ainsi que les cadres de gouvernance à établir pour assurer le partage responsable de données. Alors, attachez vos ceintures pour un voyage de découverte aux confins de l’éthique et de la science. Bartha, bienvenue au balado.
Bartha Knoppers :
Ravie d’être avec vous.
PK :
Bartha, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre travail? Vous êtes une avocate spécialisée en droit de la santé et une bioéthicienne de renommée mondiale dans les domaines spécialisés et très complexes de la procréatique et de la génomique. Mais en termes très simples, comment expliquez-vous aux gens ce que vous faites?
BK :
Je pense que la meilleure façon de l’expliquer est de dire comment j’ai appris à faire face à l’examen attentif des douaniers ou des agents frontaliers quand j’arrive quelque part. Lorsque je fais du travail international, du travail comparatif, je voyage beaucoup, comme vous le savez, pour découvrir ce qui se fait dans d’autres pays sur certains sujets. Donc, quand j’arrive à la frontière, la personne chargée des passeports me demande : « Que faites-vous dans la vie? ». Si je réponds que je travaille dans le domaine du droit et de la biotechnologie, je vois que cela ne suffit pas, et que la personne se demande de quoi je parle. Alors je vais vous donner quelques exemples. En 1978, je disais que je m’occupais de l’affaire de Louise Brown, le bébé-éprouvette. Ah, le bébé-éprouvette! Et en 1997, je disais que je travaillais sur Gattaca. « Ah oui, j’ai vu ce film, c’est vraiment quelque chose. Est-ce vrai? Est-ce que ça se passe vraiment? Est-ce qu’il y a des gens qui vont être sélectionnés, d’autres rejetés, et ainsi de suite? »
Et puis en 2006, je parlais souvent de Dolly. Tout ce que j’avais à dire, c’était « Dolly ». « Ah, le mouton? Ah oui, c’est de la science-fiction, allons-nous tous être clonés? » Et mon dernier exemple aurait probablement été en 2018 : les jumelles chinoises génétiquement modifiées. Et c’est étonnant, mais juste en donnant ces exemples, ils savent de quoi je parle parce qu’il ont lu quelque chose à leur sujet ou en ont entendu parler. Ils ne lisent peut-être pas Nature ou Science, mais ils comprennent les enjeux entourant ces découvertes scientifiques, et parfois ça leur fait peur, habituellement ils trouvent ça excitant, mais tout le monde veut en parler.
PK :
Quels exemples fantastiques. Merci beaucoup. Certaines lois considèrent les données génétiques comme étant plus délicates que d’autres renseignements personnels, et elles leur confèrent parfois une protection accrue. Certains appellent ça l’exceptionnalisme génétique. Quel est votre avis? Croyez-vous que les données génétiques sont plus délicates que d’autres types de renseignements personnels, et devraient-elles être régies différemment?
BK :
Si on regarde 50 ans en arrière, il y avait beaucoup de stigmatisation, même à propos du cancer, et je pense qu’on pourrait dire la même chose de l’infertilité. Ce n’est que récemment que l’on a commencé à parler de l’infertilité, qu’on reconnaît qu’elle existe, qu’elle concerne 15 % de la population, et pourtant elle est cachée. Personne n’en parle. Il ne fait aucun doute que les données génétiques sont uniques parce qu’elles sont de nature familiale. Il ne s’agit donc pas seulement de vous, mais aussi de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos grands-parents et de vos enfants actuels ou futurs. Mais à part cela, beaucoup de données relatives à la procréation sont délicates. Les maladies transmises sexuellement, c’est un sujet délicat, comme les maladies infectieuses. La COVID fait partie de la normalité désormais. C’est comme une nouvelle sorte de grippe, mais quand elle s’est déclarée, les gens traversaient la rue au lieu de croiser quelqu’un. Alors, attraper la COVID, ou l’attraper une seconde fois, c’était nouveau et horrible, et ça voulait dire qu’on avait commis une erreur.
Ce que j’espère, c’est qu’après que la génétique passera du domaine de la recherche au domaine clinique dans ce que l’on appelle la médecine génomique, on pourra subir une prise de sang, se faire peser et mesurer, passer une tomographie mais aussi, des tests génétiques qui font partie d’une liste de services médicaux intégrés et normalisés que l’on peut recevoir quand on en a besoin. Mais il faudra du temps pour normaliser et intégrer cela, l’accepter comme élément de notre condition humaine, comme on accepte d’avoir une petite ou une grande taille, ou d’être plus ou moins gros, et ainsi de suite.
PK :
Vous avez parlé du passage de la génomique de la recherche aux applications cliniques. Parlons donc d’un cas où des données génétiques sont utilisées couramment dans le contexte de la santé. Les programmes de dépistage néonatal, par exemple, consistent généralement à piquer le bébé au talon pour prélever un échantillon de sang à analyser afin de déceler de façon précoce un éventail de troubles et de maladies rares en vue de les traiter. Pourquoi ces programmes revêtent-ils tant d’importance sur le plan de la santé publique?
BK :
Eh bien, c’est mon sujet préféré. Pourquoi? Parce que c’est ce qui m’a amenée à la génétique. J’étais satisfaite de mon travail en procréatique, et un jour, le Dr Charles Griever m’a donné un coup de fil et m’a demandé : « Professeure Knoppers, vous devez visiter un programme de dépistage néonatal ». C’était en 1985, une assemblée qui avait lieu aux États-Unis. Je lui ai répondu : « C’est quoi, le dépistage néonatal? » J’avais eu des enfants mais j’avais oublié ça, même si mes propres enfants l’avaient eux-mêmes subi. Ça consiste à examiner une population sans restriction, en supposant que tous les nouveau-nés sont présumés asymptomatiques. Bon, évidemment, si l’enfant souffre de quelque chose, on l’emmène tout de suite aux soins intensifs néonatals, mais on fait ce dépistage chez tous les enfants que l’on présume asymptomatiques pour déterminer s’ils présentent un risque d’être atteints d’un trouble traitable. Ce n’est qu’à ce moment-là, lorsque l’enfant est présumé à risque, que l’on fait un test diagnostique en tant que tel.
Donc dans un certain sens, un élément du droit de l’enfant à la santé, selon mon point de vue actuel, est son droit que l’on découvre s’il est à risque. Donc je suis tout à fait favorable aux programmes de dépistage néonatal, et le nombre de maladies qui font l’objet de ce dépistage, et je ne parle pas de tests mais de dépistage, varie même à l’intérieur du Canada, par exemple, il s’échelonne de quatre à 33, et il en va de même ailleurs dans le monde, selon que les pays peuvent payer pour les traitements. N’oublions pas que ces données doivent être exploitables, ou du moins exploitables sur le plan clinique, et le nombre de maladies varie selon que l’on a les moyens ou non de se permettre un traitement. Les tests, les analyses, les suivis et les traitements que l’on peut se permettre d’offrir varient selon les pays. Mais dans un certain sens, cela permet à chaque nouveau-né d’être inscrit, d’exister. Il s’agit donc d’une forme d’universalité qui va bien au-delà du contexte médical de la santé publique. Donc je suis tout à fait d’accord. J’estime que l’enfant à risque a le droit que l’on découvre qu’il est à risque. Pour moi, c’est ça le dépistage néonatal.
PK :
Vous dites que ces tests sont administrés depuis un bon bout de temps. Quelle a été leur évolution au fil des ans? Fait-on le dépistage d’un plus grand nombre de maladies, et est-ce que les tests ont évolué au fil des ans? Quelles sont vos constatations?
BK :
Il est indéniable que l’on tente de dépister plus de maladies, et qu’il existe également de nouvelles technologies; la plus récente est le séquençage du génome entier, dont le coût et à la baisse. Un jour, il sera possible d’effectuer un tel séquençage pour tous les nouveau-nés. Et je me dis, ouf, devrait-on vraiment le faire? C’est comme si on avait un bulletin futuriste pour cet enfant avant même qu’il n’ait atteint l’âge d’un an. Dans certains pays, au Canada, partout dans le monde, on se demande comment utiliser de façon responsable cette technologie, dans toute sa précision. Et on commence à le faire, en tenant des discussions, en donnant des conseils, etc. Aucun pays ne l’a fait encore, on est au stade de la recherche. Prenons des ensembles de maladies, disons 300 des maladies les plus graves dont nous savons qu’une population particulière pourrait être à risque.
Donc même quand on fait le séquençage du génome entier, il reste possible de limiter les maladies à celles qui sont traitables. On peut alors se demander que faire si la maladie n’est pas traitable à la naissance mais se manifestera à l’âge de 35 ou 40 ans. Doit-on en faire le dépistage chez les bébés? Parce que ça pourrait intéresser – le cancer du sein par exemple, ça pourrait intéresser d’autres membres de la famille, et c’est là que l’on constate qu’on se trouve dans une zone grise, et que personne n’a encore tiré de conclusion. Les Européens sont plus conservateurs; ils veulent se limiter aux maladies sur lesquelles on peut agir pendant l’enfance. Et après l’âge de 18 ans, on peut se faire tester soi-même. Les Américains, au contraire, insistent sur la prérogative des parents de soumettre leurs nouveau-nés à un dépistage s’ils peuvent obtenir tout ce qu’ils veulent. Donc il s’agit plutôt d’un modèle transactionnel privé, alors que dans la plupart des cas, le dépistage néonatal relève de la santé publique, au niveau de la population. Donc le séquençage du génome entier est plein de promesses et je trouve ça très stimulant, mais il faudra tenir bien des débats et discussions avant de le faire au Canada.
PK :
Vous avez mentionné les parents; qu’en est-il du consentement des parents dans tout ça?
BK :
Je suis d’avis que l’enfant a le droit qu’on découvre s’il est à risque. Il s’agit de sa santé, et de son droit au meilleur état de santé possible conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il s’agit donc des droits de l’enfant. Donc, je crois qu’il faut informer les parents lors d’un dépistage prénatal. Il faut leur dire qu’il aura lieu. Il faut préciser quelles sont les maladies que l’on cherche à dépister, et que si l’enfant est à risque, des tests seront effectués à des fins de confirmation, le consentement des parents sera obtenu, à ce stade, celui des tests, de la conservation possible des données à des fins de validation, le consentement à la recherche, et tout ça. Oui, il faut leur dire, il faut en discuter, mais je ne crois que le dépistage néonatal ne devrait jamais être refusé.
PK :
Vous avez mentionné le droit de l’enfant de savoir et de subir ces tests; qu’en est-il du droit de l’enfant de ne pas être informé quand il devient majeur? Sur le plan éthique, y a-t-il des facteurs ou des lignes directrices à envisager pour les cas où un enfant ne veut peut-être pas être informé, par exemple, de son risque de développer une maladie incurable quand il sera dans la trentaine?
BK :
C’est une très bonne question et c’est pourquoi à l’heure actuelle, quand on parle de dépistage néonatal, il s’agit de maladies qui se déclarent pendant l’enfance. Alors ils seraient au courant. S’ils prennent des médicaments, reçoivent un traitement, se font opérer ou doivent suivre un régime alimentaire spécial, par exemple, ils savent de quoi ils sont atteints. Tout ce qui est au-delà de ce que l’on peut gérer pendant l’enfance, je crois vraiment qu’une fois majeure, la personne peut alors s’informer si elle veut le savoir. Je ne pense pas qu’il faille révéler tout ça n’importe comment dès la naissance.
PK :
Vous avez parlé du consentement des parents à d’autres utilisations, par exemple à des fins de recherche ou autre, et je crois que malgré leurs avantages, les programmes de dépistage néonatal sont controversés dans certains pays, notamment sur le plan de la protection de la vie privée, lorsque ces échantillons sont utilisés à d’autres fins. Qu’est-ce qui a mal tourné dans certains de ces cas?
BK :
Quand on fait un test de Guthrie, on prélève des gouttes de sang qui sont placées sur des cartes de papier buvard, et il faut conserver ces cartes à des fins de validation parce que le dépistage présente un taux très élevé de faux positifs. Supposons que l’on fait le dépistage chez des milliers, disons 70 000 nouveau-nés au Québec chaque année, il faudra valider ces cartes. Supposons que d’après le laboratoire de dépistage, un nouveau-né est atteint de telle ou telle maladie ou pourrait en être atteint, il faut vérifier la carte et trouver l’enfant. Donc il reste toujours des cartes et on les conserve pendant un certain nombre d’années. Certains pays les conservent en permanence, mais la plupart n’en ont pas les moyens ou ne veulent pas en prendre la responsabilité, alors elles sont détruites. Mais si on veut les conserver plus longtemps et les utiliser à des fins de recherche, je crois qu’il faut demander le consentement.
Je crois vraiment que c’est à ce moment-là qu’intervient le consentement, particulièrement à des fins de recherche. Même si les cartes étaient anonymisées, je pense qu’il faudrait au moins informer les parents qu’elles seront conservées pendant un certain nombre d’années, puis anonymisées et agrégées. On pourrait découvrir que sur 70 000 enfants, 3 000 avaient telle ou telle maladie, sans savoir qui et sans pouvoir les retrouver. Une fois la recherche effectuée, on ne pourrait jamais revenir en arrière. Ce type de recherche est effectué à des fins de santé publique, et à mon avis il est dans l’intérêt du public et des ministères de la santé de savoir quoi faire ou non dans une circonstance particulière. Mais à moins que les données soient anonymisées et agrégées, je crois qu’il faut tout à fait obtenir un consentement éclairé. Mais il faut le dire aux gens, il faut les informer.
PK :
Et quand on ne le fait pas, c’est là que, je suppose, les choses tournent mal.
BK :
Oui.
PK :
Et dans certains pays, malheureusement, tous les échantillons ont dû être détruits en raison d’un manque de transparence et du fait que le consentement n’avait pas été obtenu dès le départ, comme vous dites. J’aimerais aborder les biobanques de recherche. Vous avez consacré une bonne partie de votre carrière à la gouvernance de ces biobanques et notamment aux enjeux relatifs au consentement. Donc pour résumer, les biobanques, évidemment, recueillent des échantillons de sang, mais également d’autres renseignements sur la santé de milliers, voire de millions de personnes, à des fins de recherche. Pourquoi les biobanques revêtent-elles tant d’importance et pourquoi les chercheurs tentent-ils d’y verser le plus possible d’échantillons de sang ou de renseignements personnels sur la santé?
BK :
Les biobanques sont structurées systématiquement et analysées en fonction d’un type de maladie ou d’une population particulière ou d’un sous-ensemble de la population. Ce sont des ressources. Elles peuvent servir de témoin pour savoir si dans une population – on a un échantillon d’urine, un échantillon de sang, des données socioéconomiques, des données démographiques et avec le temps, des données longitudinales, qu’arrive-t-il à ces personnes? Donc elles représentent un service de validation qui permet de savoir ce qui se passe dans une population donnée avec le temps.
Donc pour comprendre les stades de développement, on a besoin également de biobanques pédiatriques. Nous avons besoin de savoir combien de personnes présentent une démence précoce après l’âge de 45 ans dans une population donnée. Est-ce à cause de l’alimentation? Est-ce l’environnement? Est-ce l’usine de leur voisinage qui émettait des polluants? Il n’est pas possible pour l’État de structurer son système universel de soins de santé et d’affecter l’argent là où on en a besoin, ni de structurer la recherche, sans disposer de biobanques que nous pouvons utiliser pour mener des recherches cliniques qui font intervenir des particuliers, des collectivités ou des familles. Donc c’est une façon pour les gens d’apporter leur contribution, non pas comme patients ou personnes, mais comme citoyens, à une ressource qui se révélera utile aux autres dans l’avenir.
PK :
Donc pourquoi y a-t-il un problème lorsque certaines personnes ne veulent pas être incluses dans une biobanque ou refusent leur consentement à ce que leurs échantillons ou d’autres données personnelles soient utilisés?
BK :
C’est leur droit, et elles peuvent refuser pour quelque raison que ce soit. Le problème, c’est que ce refus procède souvent d’une méfiance envers le monde de la médecine. Mais quand une personne ne participe pas, sa collectivité, ses circonstances socioéconomiques familiales, etc., ses origines, l’origine de ses grands-parents, ainsi de suite, ce n’est pas consigné. Donc ces ensembles de données ne sont pas représentatifs de ce que sont les populations modernes, qui sont hétérogènes plutôt qu’homogènes. Et on nous dit, « il n’y a pas assez de diversité dans vos ensembles de données ». Eh bien oui, nous avons besoin de plus de gens qui ne sont pas d’origine blanche ou européenne. Aujourd’hui, au Canada, selon Statistique Canada en 2022, 24 % de la population canadienne actuelle a des origines non européennes ou non blanches. Nous avons besoin de données sur ces gens. Nous n’aurons pas les bons médicaments, les bons appareils, les bons traitements, une bonne compréhension de leur situation s’ils sont absents des ensembles de données ou des biobanques. Donc il nous faut, je crois, une meilleure littératie génomique, si je puis dire, ou une meilleure littératie en matière de santé, parce tout le monde profite de ces ressources.
PK :
Vous avez parlé de la confiance du public. Qu’est-ce qui permettrait d’accroître la confiance du public et l’inciter à participer aux biobanques de recherche?
BK :
Avant tout la transparence. Ce n’est pas si difficile de publier, tous les trois mois, un bulletin rédigé en langage simple, en anglais, en français, ou dans d’autres langues, pour donner les dernières nouvelles, parler des projets en cours, expliquer pourquoi ils sont réalisés. Et à nouveau trois mois plus tard, de donner les dernières nouvelles, de dire ce que nous comptons faire, des projets qui se poursuivent ou qu’on a abandonnés et pourquoi. Il n’y a pas de transparence. Nous n’avons pas une gouvernance suffisamment visible, ni de reddition de comptes évidente quand il se produit des erreurs. Donc une fois que nous aurons ça et que les gens sauront où s’informer, pourquoi consulter Google? Pourquoi ne pas lire le bulletin trimestriel du ministère de la Santé pour apprendre ce qui se passe? Voilà. Je pense que nous avons besoin de ces trois éléments : gouvernance visible, transparence et reddition de comptes.
PK :
Ajouteriez-vous aussi la possibilité de ne pas participer? Si on demande aux gens de donner leur consentement, je suppose que ça les rassure beaucoup de savoir que s’ils changent d’idée, ils peuvent retirer leur consentement à un moment donné, et que même s’ils ne le font pas, le fait de savoir qu’ils exercent un contrôle et qu’ils peuvent changer d’avis, je crois, est un autre facteur important. Qu’en pensez-vous?
BK :
Tout à fait, c’est un droit fondamental. C’est dans le Règlement général sur la protection des données d’Europe, le droit de retirer son consentement, et ça fait évidemment partie de l’éthique de la recherche, et absolument de l’éthique en santé. Si je ne veux pas aller chez le médecin, ou si je veux jeter à la poubelle l’enveloppe qui me rappelle de subir un test de dépistage du cancer du sein, c’est mon choix. Évidemment que nous avons le choix; absolument. Je me demande pourquoi les gens pensent qu’ils ne peuvent pas retirer leur consentement en tout temps. C’est fondamental.
PK :
Vous avez écrit que vous tentez de sensibiliser les gens à la solidarité comme concept de base aux fins de la gouvernance de la recherche en santé. Que voulez-vous dire par solidarité?
BK :
Je suis une enfant des années 60, et la solidarité me rappelle un peu les manifestations, les causes que l’on défendait, et ce n’est pas ce que je veux dire, et ce n’est pas non plus le contraire de l’individualisme. Dans ce contexte, celui de la recherche en santé, dans la santé publique, il s’agit à mon avis d’agir comme citoyen et non simplement comme individu. Nous ne vivons pas dans des cavernes; nous vivons en société, et dans le contexte du contrat social, nous devons agir dans notre intérêt mutuel. Et pour moi, le fait de participer, quand on le souhaite, à la recherche, en fournissant une partie de ses données, pas nécessairement tout son dossier médical, mais quelques données essentielles dont on a besoin pour assurer l’efficacité des systèmes de santé et mieux les cibler, c’est être un citoyen qui est solidaire des autres citoyens. Nous sommes tous réputés en santé, mais également à risque, et on ne peut faire la différence ni planifier si on ne participe pas dans une certaine mesure en tant que citoyen.
PK :
Voyez-vous une différence entre la notion de solidarité dans le contexte de la recherche universitaire d’une part ou dans le contexte de la recherche commerciale ou à but lucratif d’autre part?
BK :
Eh bien, quant à ces types de recherche, l’un ne va pas sans l’autre. Nous n’avons pas l’argent dont l’industrie dispose pour élaborer des traitements. Créer un médicament ou un appareil nécessite une dizaine d’années et beaucoup d’investissements, beaucoup d’essais cliniques pour en assurer l’innocuité ou la sécurité. C’est un fait que les universités et les chercheurs ne peuvent pas supporter ce fardeau. Donc nous avons besoin de l’industrie, du secteur commercial. Condamner le secteur privé, c’est trop facile. Je crois que les entreprises, si on leur demande et si on apprécie leur contribution, peuvent être conscientes de leurs responsabilités collectives ou sociales, et souhaitent beaucoup agir de façon responsable et être considérées comme étant des entreprises responsables, qui comprennent les critiques ou le scepticisme du public. Évidemment, elles doivent respecter leurs obligations en vertu de la loi, envers leurs actionnaires, etc. Le profit fait partie de leur existence.
C’est donc un équilibre délicat. Quand on leur demande, les entreprises réclament des cadres d’éthique. Elles veulent savoir comment contribuer au partage de données sans que l’on considère qu’elles accumulent ou volent des données. Et au départ, je suppose que l’entreprise est de bonne foi, que tout le monde est responsable sur le plan moral. Je pars de là. Ce serait cynique de travailler à la coordination internationale, à la collaboration, à l’élaboration de cadres, de principes, de traités, etc., sans cette présomption de bonne foi et de responsabilité sociale. Aussi bien alors ne plus travailler dans ce domaine.
PK :
Pendant des décennies, vous avez donc travaillé sans relâche au sein d’une organisation internationale que vous avez fondée et qui s’appelle P3G, Public Population Project in Genomics and Society. Votre mission a toujours été de promouvoir l’harmonisation des normes techniques, des cadres de politiques et des outils pour les biobanques du monde afin de faciliter le partage de données entre pays à l’échelle internationale. Croyez-vous qu’une telle harmonisation est possible aujourd’hui, par voie législative ou dans la pratique?
BK :
P3G a existé pendant 13 ans. Notre objectif était de faire en sorte que dans la mesure du possible, les biobanques soient en mesure de communiquer, non pas de les rendre identiques, mais de prévoir une certaine interopérabilité et une harmonisation sur le plan des variables recueillies dans ces biobanques longitudinales. Pourquoi? Parce que si les variables qu’on recherche sont harmonisées à au moins 65 %, on peut parvenir à la signification statistique dans la moitié des cas.
Supposons que vous ayez besoin d’une cohorte de 10 000 femmes atteintes du cancer du sein. Vous faites appel à la UK Biobank, qui est la plus importante comme vous le savez, avec un demi-million. Elle n’a pas 10 000 femmes âgées disons de 45 à 50 ans ayant le cancer du sein. Mais si on pouvait combiner ses données à celles du Japon, de l’Estonie et du Québec, par exemple, alors il suffirait probablement d’un mois pour obtenir votre cohorte de 10 000 et pouvoir entreprendre votre recherche. Donc c’est la signification statistique, l’interopérabilité, le partage de données sur des personnes de pays différents. Donc notre idée et l’objectif de P3G étaient en quelque sorte de lancer l’harmonisation des données épidémiologiques, mais également en fonction de principes éthiques communs.
PK :
Et je suppose que ce travail est d’autant plus important lorsqu’il s’agit d’étudier, par exemple, des maladies rares afin, comme vous le dites, de disposer de cohortes d’une taille suffisante pour obtenir une signification statistique pour ces maladies rares.
BK :
On dit de ces maladies qu’elles sont rares, mais pas tant que ça; je lisais par hasard qu’elles sont peu fréquentes mais qu’elles touchent des millions de personnes. Voilà le paradoxe des maladies rares. En Europe, 30 millions de personnes sont atteintes de maladies rares. Comment localiser ces gens en nombre suffisant pour faire quelque chose, sachant comment elles vivent et ce qu’elles ont? Je crois que la communauté des personnes atteintes de maladies rares est absolument fantastique pour sa participation à la création de biobanques, au partage de données à l’échelle internationale, etc.
PK :
Vous avez dit que P3G a existé pendant un certain nombre d’années, mais votre travail sur ce sujet à l’échelle internationale a pris d’autres formes, par exemple, la Global Alliance for Genomics and Health, et vous poursuivez ces efforts d’harmonisation dans le cadre de cette alliance mondiale élargie.
BK :
Oui, la Global Alliance est un peu mon ado, alors que P3G, c’était mon bébé. En 2003, la dernière carte du génome a paru dans Nature. Donc nous avons une carte, nous savons où se trouvent les gènes, mais nous ignorons ce qu’ils signifient. Et nous ne savons pas s’ils changent. Si vous vivez dans un pays et que 50 ou 60 ans plus tard, vous êtes maintenant Américain, Brésilien ou Sud-Africain, qu’est-ce qui a changé dans votre phénotype? Le génotype s’exprime par l’entremise du phénotype, sur lequel l’environnement et le contexte socioéconomique et autre exercent une influence. Donc à GA4GH, nous avons dit, « nous savons où les gènes se trouvent, mais pas les maladies qui y correspondent ». Et notre objectif était de commencer par un cadre s’appuyant sur les droits de la personne.
Les droits de la personne sont universels. Ils sont conférés à tous et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, puis ils ont été inscrits dans un pacte international signé et ratifié par 171 pays. On peut faire respecter ces droits, sur le plan légal. On peut demander au pays, au ministère, « qu’avez-vous fait de mes droits? » Parce que le Canada a signé et ratifié. Nous nous sommes concentrés sur trois de ces droits, mais surtout sur le droit de participer aux bienfaits qui résultent des progrès scientifiques. Et nous avons conclu que si chacun a le droit de participer à ces bienfaits, la mission de GA4GH sera de faire valoir ce droit, en réunissant de nombreuses organisations pour y parvenir en élaborant des politiques, des outils et des normes.
PK :
Fascinant et très inspirant, Bartha. Revenons un peu au Canada. Vous avez fait partie récemment d’un comité consultatif d’experts qui fournit des conseils aux gouvernements de l’ensemble du pays pour l’élaboration d’une stratégie pancanadienne de données sur la santé. Quels sont vos travaux, et les constatations du comité consultatif d’experts sur les lacunes quant à la façon dont les données sur la santé sont recueillies, partagées et utilisées de nos jours au Canada?
BK :
En ce qui concerne la stratégie pancanadienne de données sur la santé, nous avons constaté que quand on veut utiliser des données scientifiques à des fins cliniques, les cliniciens n’ont pas nécessairement l’habitude de partager des données. Ils se fondent sur le serment d’Hippocrate, la confidentialité des patients, le respect de leur vie privée, ils y croient et il s’agit de valeurs appréciables. Cependant, quand on ne peut même pas envoyer son dossier à un autre hôpital ou le rendre accessible à des chercheurs, même quand ils reçoivent l’autorisation d’un comité d’éthique, ils n’ont pas vraiment la mentalité voulant que les données sur la santé doivent être partagées afin de pouvoir comprendre ce qu’il faut faire, dans quelle direction nous devons aller. Il y a encore du cloisonnement. Ils obtiennent un avis juridique avant d’envoyer quelque chose parce qu’ils ont très peur, même quand on a obtenu le consentement des patients, même quand le patient comprend que leurs données peuvent leur être utiles si elles font l’objet d’études, mais qu’elles pourraient également aider le prochain patient atteint de la même maladie.
Et qui sait? Peut-être que dans dix ans, cette maladie pourra être traitée, voire guérie. Donc il y a le problème du cloisonnement, du rôle de dépositaire, et l’absence de ce que j’appelle la littératie en santé publique, la littératie génomique, qui permettrait aux gens de comprendre que ces données sont importantes pour tout le monde. Et il est beaucoup plus difficile que nous le pensions de faire en sorte que les hôpitaux se partagent des données à l’intérieur d’une même province ou entre provinces. Je vais vous donner un exemple. Pendant la COVID, nous examinions des échantillons de personnes qui y avaient succombé, et nous avons lancé un projet qui avait pour but de déterminer ce que l’on appelle la comorbidité et la comortalité – telle ou telle personne était-elle plus vulnérable, et pourquoi d’autres ne l’attrapaient pas. Pourquoi étaient-elles si résistantes?
Et pourtant quand il s’agit de personnes décédées, tout le monde nous disait qu’il fallait demander aux proches parents, mais personne ne pouvait entrer dans les hôpitaux, n’est-ce pas? Impossible de s’asseoir et de discuter, et si on les appelle chez eux, on se fait accuser d’atteinte à la vie privée, on dit qu’on dérange la famille. Il y avait donc beaucoup de difficulté à comprendre que les données provenant de personnes décédées pouvaient être utilisées afin de comprendre la COVID, dans l’intérêt public. Honnêtement, je crois que parfois, dans le cadre d’une pandémie, les mesures de précaution qui sont en place doivent être proportionnelles et qu’il faut éviter de les appliquer de façon extrême.
PK :
Le comité consultatif d’experts a souligné la nécessité de créer un système de données sur la santé qui soit axé sur les personnes. Qu’est-ce qu’un tel système?
BK :
Oui. Les renseignements sur la santé axés sur la personne sont évoqués dès la première ligne de la Charte des données sur la santé, où on dit que ces renseignements sont conçus pour suivre la personne afin qu’on puisse y accéder et les utiliser à des fins cliniques et analytiques. Donc ces renseignements nous suivent. Et on peut espérer qu’un jour, tout le monde pourra consulter son dossier et le partager avec n’importe qui. Cela reste encore à réaliser. Mais quand on dit « axé sur la personne », on veut dire que c’est la personne qui vient en premier, et qu’après, on peut contribuer au système. Mais pour ça, je crois que nous devons vraiment rehausser la littératie en matière de données sur la santé, pour prendre conscience du fait que ces données ne concernent pas que nous.
PK :
Vous avez mentionné la Charte des données sur la santé que le groupe consultatif d’experts a recommandée. Qu’y a-t-il d’autre dans cette charte? Quels sont les autres principes et valeurs que vous préconisez?
BK :
Il s’agit d’une charte des données sur la santé qui est très courte, compréhensible, et que l’on peut partager. Elle avait pour but d’encadrer de façon très brève différentes valeurs. Il s’agit de mettre les personnes et les populations au cœur de toutes les décisions sur la divulgation, les données sur la santé, l’accès à ces données et leur utilisation. Ces données doivent donc suivre la personne, comme je l’ai dit, et être fondées sur une terminologie commune, des codes compréhensibles, il faut viser la qualité, la sécurité et l’accessibilité, et être utilisées dans le cadre de politiques, de programmes et de services, dans des statistiques, et dans la recherche dans l’intérêt public vu l’importance de la science ouverte. La charte aborde également l’innovation, la littératie en matière de données sur la santé, l’harmonisation et le soutien à la souveraineté des données des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Mais ce qui est important c’est une toute petite phrase au bas de la page : « La Charte des données sur la santé est fondée sur et inspirée par les droits fondamentaux de la personne dont la nature universelle transcende les différences juridictionnelles et disciplinaires ». C’est pourquoi elle ne s’appelle pas « charte canadienne de la santé », mais bien charte de la santé, reconnaissant ainsi les normes internationales, notamment en matière de gouvernance des données.
PK :
J’aimerais également souligner que l’importance de respecter la confidentialité et d’assurer la sécurité des données fait partie des valeurs de votre charte.
BK :
Vous avez tout à fait raison. Donc la charte exige la qualité, la sécurité et la confidentialité des données sur la santé afin de promouvoir le bien-être des personnes et des populations et de réduire les préjudices. Merci de l’avoir souligné.
PK :
Vous savez que je pourrais vous parler pendant des heures, Bartha, mais je sais que notre temps est compté et je ne veux pas vous laisser partir sans vous poser une dernière question. Vous savez que l’une des priorités stratégiques de mon bureau est la confiance dans la santé numérique, et notre objectif à ce sujet est de promouvoir la confiance dans le système de santé numérique, mais également de favoriser l’utilisation novatrice des renseignements personnels sur la santé à des fins de recherche et d’analytique dans la mesure où elle sert le bien public. Que conseillerez-vous à mon bureau pour atteindre cet objectif, c’est-à-dire favoriser non seulement la confiance dans le système de soins de santé numérique, mais aussi l’utilisation novatrice des renseignements personnels sur la santé à des fins de recherche pour le bien public?
BK :
Nous avons besoin d’outils rédigés au niveau, je dirais, de la 8e année. Des outils que l’on peut utiliser dans un comité d’église, dans les écoles, dans des groupes de discussion, des outils que je peux utiliser quand j’enseigne à des étudiants à la maîtrise. Et nous devons savoir ce qui se passe, ce que vous faites. Vous pouvez élaborer des scénarios que les gens pourront comprendre, car il y a trop de contenu abstrait qui ressemble à du langage de marketing ou à du charabia du gouvernement. Il faut des scénarios brefs, éloquents, intéressants, qui sonnent vrai. Si les gens comprennent que leurs données peuvent être utilisées à des fins de recherche ou pour assurer la qualité ou la protection de la vie privée dans les hôpitaux, mais qu’il s’agit d’un système d’apprentissage. Donc s’ils participent à la recherche ou donnent accès à leurs données, à leur dossier médical, à un ensemble de données de base, le système de santé se servira des données d’autres patients et des connaissances tirées de cette recherche, et cela leur sera bénéfique à eux ou à d’autres personnes.
Je crois qu’il nous faut mettre à la disposition du public des outils plus intéressants, brefs et compréhensibles. Comme je l’ai mentionné au début de cette entrevue, si tous les quatre mois il y avait un bulletin à consulter dans un site, et que des élèves qui font leurs devoirs, des gens qui effectuent des recherches pour leur dissertation, des universitaires qui ont besoin d’un sujet intéressant à aborder dans leur groupe communautaire le lisent et se disent, regardons ces scénarios, parlons-en. Il n’y a pas de bonnes réponses quand on parle des valeurs. Ça veut dire quoi la protection de la vie privée pour toi? Qu’est-ce que ça veut dire pour moi? C’est quoi, vraiment, le partage de données? Il faut donc intensifier le dialogue, mais également de façon plus éclairée, contextualisée et ancrée dans la réalité.
PK :
Voilà d’excellents conseils. Et pour revenir à notre point de départ, j’ai dit que nous partions à la découverte, et c’est exactement ce que nous avons fait. Merci, Bartha, d’avoir participé à notre balado malgré votre emploi du temps très chargé.
BK :
Il n’y a pas de quoi.
PK :
Nous aimerions dédier cet épisode spécial à une amie commune qui n’est plus parmi nous. Susan Zimmerman, directrice administrative du Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche, était une véritable pionnière dans les domaines de la santé, du droit et de la politique. Elle a consacré les vingt dernières années de sa vie à renforcer les normes éthiques nationales du Canada pour la recherche avec des êtres humains dans le cadre de politiques et dans la pratique. Je sais que je parle au nom de Bartha ainsi que de nombreux autres membres de la communauté, en reconnaissant son énorme contribution à l’éthique de la recherche au Canada. Sue, cet épisode est pour toi.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur les sujets que nous avons abordés, vous trouverez des liens vers des ressources dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi visiter notre site Web à cipvp.ca pour en savoir plus sur nos travaux pour favoriser la confiance dans la santé numérique, ou encore nous appeler ou nous envoyer un courriel si vous avez besoin d’aide ou de renseignements généraux concernant les lois ontariennes sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Merci d’avoir écouté cet épisode de L’info, ça compte. À la prochaine.
Ici Patricia Kosseim, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, et vous avez écouté L’info, ça compte. Si vous avez aimé ce balado, laissez-nous une note ou un commentaire. Si vous souhaitez que nous traitions d’un sujet qui concerne l’accès à l’information ou la protection de la vie privée dans un épisode futur, communiquez avec nous. Envoyez-nous un gazouillis à @cipvp_ontario ou un courriel à [email protected]. Merci d’avoir été des nôtres, et à bientôt pour d’autres conversations sur les gens, la protection de la vie privée et l’accès à l’information. S’il est question d’information, nous en parlerons.
Bartha Maria Knoppers, Ph. D., est une experte et pionnière de renommée mondiale dans les domaines de la santé, du droit et de la bioéthique, et particulièrement de la génomique. Ses travaux novateurs ont profondément transformé notre compréhension de l’intersection complexe entre la science, le droit, la technologie et l’éthique. Elle est actuellement directrice du Centre de génomique et politiques de l’Université McGill, où elle collabore avec des organisations internationales, des gouvernements et des décideurs pour contribuer à établir les critères éthiques qui protègent les droits de la personne tout en favorisant la santé et le bien-être des personnes et des collectivités.
- L’exceptionnalisme génétique [03:46]
- L’utilisation des données génétiques dans les soins de santé [05:50]
- Le séquençage du génome et la prédiction des résultats en matière de santé [6:23]
- Le consentement des parents au dépistage néonatal [10:45]
- Les aspects touchant la vie privée du séquençage génomique aux fins de la recherche en santé [12:39]
- Les biobanques et l’utilisation des données à des fins de recherche en santé [14:45]
- La gouvernance, la transparence et la reddition de comptes dans la recherche en santé [18:40]
- Le partage de données entre chercheurs universitaires et commerciaux [20:41]
- P3G – Public Population Project in Genomics and Society [24:05]
- La Global Alliance for Genomics and Health (Canada) [26:58]
- La stratégie canadienne de données sur la santé [29:11]
- La Charte des données sur la santé du Canada [33:10]
- Conseils pour favoriser la confiance dans la santé numérique [35:07]
Ressources :
- Centre de génomique et politiques (CGP)
- Centre de génomique McGill
- Le Public Population Project in Genomics (P3G)
- Réunion de la Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH) (septembre 2023)
- Les soins de santé numériques sous le régime de la LPRPS : Aperçu sélectif
- Priorités stratégiques du CIPVP 2021-2025
- La confiance dans la santé numérique (ressources du CIPVP)
L’info, ça compte est un balado sur les gens, la protection de la vie privée et l’accès à l’information animé par Patricia Kosseim, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Avec des invités de tous les milieux, nous parlons des questions qui les intéressent le plus sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information.
Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note ou un commentaire.
Vous aimeriez en apprendre plus sur un sujet lié à l’accès à l’information ou la protection de la vie privée? Vous aimeriez être invité à une émission? Envoyez-nous un gazouillis à @cipvp_ontario ou un courriel à [email protected].
This post is also available in: Anglais